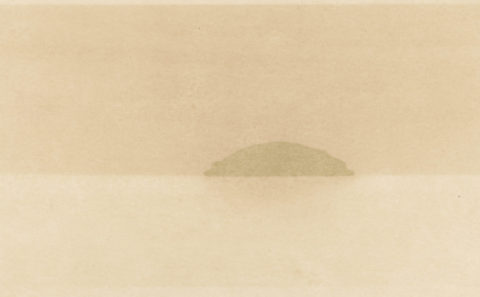Les représentations filmiques et photographiques nous aident à mieux comprendre le monde du vivant et à parfois en changer notre perception bien que le médium photographique et les couleurs de synthèse soient liés à la révolution chimique et à ses conséquences environnementales. Depuis 2016, à la suite d’une forte remise en question de ma pratique, j’explore des techniques de développements et de tirages argentique alternatifs, comme les révélateurs au café, aux plantes, ainsi que la phytotypie ou l’anthotype, en choisissant d’utiliser la lumière du soleil, l’eau, les plantes, des déchets de végétaux, des pellicules et des papiers périmés, je tente de produire autrement, dans une démarche plus durable et plus éco-responsable. Un travail qui me mène à questionner les pratiques artistiques face au dérèglement climatique, mais aussi à m’attarder sur les modes de représentations de la nature dans l’anthropocène. Mes récents travaux questionnent l’apparition et la disparition de l’image et de ce qu’elles représentent. Car, parfois éphémères, les procédés aux plantes impliquent que l’image puisse se transformer ou disparaître. Je conçois alors, que mes images, comme des formes mouvantes, sont sensibles à l’environnement dans lequel elles de trouvent et peuvent évoluer. J’aime penser que mes images sont « vivantes ».
En 2022, je rejoins l’atelier de recherche et création « chromoculture » à l’ENSAD Limoges, conçu par Arnaud Dubois et Cécile Vignau. Chromoculture consiste à développer et transmettre les pratiques des couleurs végétales en Art et en Design autour d’un jardin planté dans le parc de l’école. Au sein de ce projet, je développe un travail de recherche sur les plantes tinctoriales et leurs propriétés pour développer et teindre les films argentiques. Mon travail photographique et filmique documente la vie de ce jardin à couleurs.